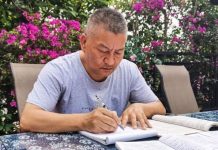Par petites touches, Joe Biden a déjà commencé à redéfinir les priorités des États-Unis au Moyen-Orient, en prenant ses distances avec l’Arabie saoudite et Israël, piliers de la stratégie anti-Iran de son prédécesseur Donald Trump, tout en tentant de renouer le dialogue avec Téhéran.
Deux semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, il a annoncé jeudi la fin du soutien américain à la campagne militaire saoudienne au Yémen, affirmant qu’elle avait «créé une catastrophe humanitaire et stratégique».
Ce premier grand discours de politique étrangère était aussi intéressant par son contenu que par ses omissions.
Le nouveau président américain n’a pas mentionné Israël lorsqu’il a évoqué la relance des alliances — il n’a d’ailleurs pas encore parlé au premier ministre, Benjamin Netanyahou.
Et il n’a cité qu’au détour d’une phrase les «menaces» de l’Iran, grand épouvantail de la politique moyen-orientale de Donald Trump.
Il a en revanche passé sous silence l’accord sur le nucléaire iranien, dont l’ex-président républicain a retiré Washington en 2018. Un accord sur lequel Joe Biden, qui était vice-président de Barack Obama lorsqu’il fut conclu en 2015, entend clairement revenir.
Droits de la personne
 «Avec Israël et l’Arabie saoudite, des alliés que Trump a réhabilités après l’ère Obama, le gouvernement Biden est prêt à prendre un peu ses distances, même si ce n’est pas de la même manière», dit Aaron David Miller.
«Avec Israël et l’Arabie saoudite, des alliés que Trump a réhabilités après l’ère Obama, le gouvernement Biden est prêt à prendre un peu ses distances, même si ce n’est pas de la même manière», dit Aaron David Miller.
Face à Israël, cet ex-diplomate américain estime que Joe Biden est probablement tenté de prendre son temps en vue des élections législatives de mars — dans l’attente de connaître le sort de Benjamin Netanyahou, lequel a rallié les conservateurs américains contre l’accord sur le nucléaire iranien.
Ce faisant, «il affiche une rupture avec la manière dont Trump a géré la relation avec les Israéliens», choyés comme jamais au cours des quatre années de son mandat, ajoute Aaron David Miller, expert du cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace.
Par rapport à l’Iran, il pense que le président américain veut montrer qu’il «ne court pas après Téhéran». Si son secrétaire d’État, Antony Blinken, a nommé un émissaire pour ce dossier explosif, il a aussi prévenu que sauver l’accord de 2015 prendrait du temps.
Mais sa prise de distance à l’égard des Saoudiens et des Israéliens, ennemis jurés des Iraniens, peut être vue comme un gage de bonne foi par la République islamique.
En mettant fin à l’implication indirecte de la première puissance américaine dans la guerre au Yémen — théâtre de la pire crise humanitaire actuelle au monde, selon l’ONU —, Joe Biden tient une promesse de campagne et met en musique sa priorité donnée aux droits de la personne.
«Retour à la normale»
Pour les mêmes raisons, Antony Blinken a décidé de retirer les Houthis de la liste noire américaine des «organisations terroristes». Ces rebelles, soutenus par l’Iran, combattent le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite.
La désignation sur la liste noire, décidée in extremis par l’administration Trump, était décriée par les organisations humanitaires, car elle risquait d’entraver l’acheminement de l’aide dans les vastes territoires contrôlés par les Houthis.
Certes, le soutien à la coalition saoudienne au Yémen avait commencé sous Barack Obama, mais le milliardaire républicain et son entourage, envers et contre tout, avaient ensuite appuyé Ryad et son prince héritier Mohammed ben Salmane, pourtant «responsable», selon le Sénat américain, de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Donald Trump a toujours dit privilégier les ventes d’armes à l’Arabie saoudite par rapport à ces accusations.
Les évolutions en cours ne signifient pas pour autant que Washington tourne le dos à ces deux alliés clés.
Joe Biden a confirmé son soutien à Ryad, notamment face aux attaques de groupes pro-Iran. Le chef de la diplomatie américaine s’est entretenu au téléphone avec son homologue saoudien Fayçal ben Farhan sur les «défis communs» aux deux pays, a rapporté samedi l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).
 Le président américain, un modéré, a aussi rejeté les appels de l’aile gauche de son Parti démocrate à remettre davantage en cause le soutien américain à l’État hébreu. Et il n’entend pas revenir sur certaines décisions unilatérales et controversées de son prédécesseur en faveur d’Israël, par exemple la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale.
Le président américain, un modéré, a aussi rejeté les appels de l’aile gauche de son Parti démocrate à remettre davantage en cause le soutien américain à l’État hébreu. Et il n’entend pas revenir sur certaines décisions unilatérales et controversées de son prédécesseur en faveur d’Israël, par exemple la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale.
Brian Katulis, du think tank proche de la gauche Center for American Progress, décrit la position du président septuagénaire comme un «retour à la normale».
«Trump avait vraiment mis tout le poids de l’Amérique sur un seul plateau de la balance dans les grands combats régionaux entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et entre Israël et les Palestiniens», dit-il. Cela «n’a pas réduit les tensions régionales et a même favorisé une escalade».AFP
AlloAfricaNews