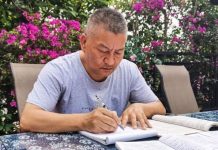L’Afrique, tant du point de vue biologique qu’au niveau des civilisations, est considérée comme le berceaude l’humanité. Sa superficie s’étend sur 30 millions de km². Ce qui fait d’elle le deuxième continent au monde par son étendue géographique, après l’Asie, 44 millions de km².
Ses dimensions lui donnent une grande variété de climats : tempéré, tropical et équatorien. Presqu’entièrement colonisée par les puissances économiques européennes au XIXème siècle, elle est aujourd’hui morcelée en 51 Etats dont les dirigeants sont dans la plupart des cas, des assassins de la démocratie et fossoyeurs des valeurs républicaines.
Economiquement, c’est un continent qui dispose de richesses agricoles, minières, pétrolières et hydrauliques immenses. Aussi possède-t-il les gisements les plus importants de minerais stratégiques (cobalt, uranium, manganèse, tantale…, etc.) et de matières précieuses (or, argent, diamants). Sans être les plus grandes du monde, ses réserves en hydrocarbures sont très importantes. Mais il reste paradoxalement l’un sinon le continent le plus pauvre de notre planète.
Les Européens qui ont dominé le monde à partir du XVème siècle, et les Américains qui les ont suivis depuis peu, perçoivent souvent, mais à tort, l’Afrique, comme un continent qui est resté à la marge de l’histoire (discours de Sarkozy à Dakar), de la connaissance donc de l’intelligence humaine, et des grandes découvertes qui ont modelé par bonds l’évolution de l’humanité. Ils continuent de croire que l’Africain n’a rien apporté à l’histoire universelle et à la construction de grandes civilisations. Ces préjugés ont formaté le sens des rapports qui lient leurs continents à celui des Noirs et ont servi de soubassement au racisme qui en découle pour justifier, à leurs yeux, le pillage éhonté de ses richesses et de ses populations, bien sûr, avec la complicité avérée de certains de leurs enfants ; ceux qui étaient sur le trône et les Matamores d’El Atrée des républiques bananières, nées des indépendances.
L’histoire atteste qu’à partir du XVème siècle, pour assurer une main d’œuvre productive et abondante aux immenses exploitations agricoles (de coton et surtout de canne à sucre), les colons dans les Amériques, surtout en Amérique du Nord, et les Européens ont organisé un immense trafic criminel en enlevant des êtres humains, parce que Noirs sur les côtes ouest-africaines et de l’Afrique centrale jusqu’en Angola. C’est ce qu’on a appelé la traite négrière. Certains historiens estiment qu’elle a concerné, en comptant les morts à l’occasion des razzias et pendant la traversée des océans et mers, de 100 000 000 à 150 000 000 d’âmes africaines dont une partie mourra également dans les camps de regroupement.
Ce douloureux passé du continent noir, qui est sans précédent dans l’histoire de l’humanité, a interrogé la conscience de certains de ses enfants et de leurs descendants. De leur démarche et réflexion est né le panafricanisme.
I – IDEES FONDATRICES ET PROJETS POLITIQUES DU PANAFRICANISME
Durant les quatre siècles d’esclavage en terre américaine, les Noirs se révoltèrent et organisèrent des insurrections. Certains s’enfuyaient dans les forêts ou les montagnes, y créèrent des villages clandestins, ou se vengèrent. Au Brésil, les esclaves révoltés ont créé la République de Palmarès, grande comme le tiers de la France. Elle résista pendant plus d’un siècle, du milieu du XVIIème au milieu du XVIIIème siècle.
Cette épreuve historique, avec le sentiment profond de dépossession sociale, économique, politique et psychologique, d’oppression, de persécution et de bannissement, a créé et entretenu un élan émotionnel vers la recherche de l’unité et de la solidarité entre les membres de la diaspora africaine. Vers la fin du XVIIIème siècle, un mouvement politique va se développer à travers les Amériques, l’Europe et l’Afrique, avec le projet d’unir les mouvements disparates en un réseau de solidarité pour mettre fin à l’oppression.
Le panafricanisme est par essence un mouvement d’idées et d’émotions. C’est une vision sociale et politique, une philosophie et une démarche dynamique tendant à unifier les Africains d’Afrique et les membres de la diaspora noire en une communauté africaine globale. Il se donne comme objectif l’unité politique de l’Afrique.
Pour ses fondateurs, il existe une personnalité africaine commune à tous les hommes, toutes les femmes de race noire. Celle-là recèle des valeurs spécifiques de sagesse, d’intelligence, de sensibilité. Les peuples noirs qui sont les peuples les plus anciens de la terre sont voués à l’unité et à un avenir commun de puissance et de gloire.
Tout en appelant les Africains à prendre conscience de leurs réalités multiples qu’il ne faut pas chercher à freiner. Pour cela, le panafricanisme les appelle à ne pas se diluer ou s’abandonner, mais plutôt à s’affirmer.
Il refuse toute idée d’assimilation, d’intégration dans le monde du blanc dominateur. Mais il vise aussi la participation des Africains à l’élaboration de la «civilisation de l’universel», c’est-à-dire à être attentif aux grands courants qui dessinent le monde pour en saisir toute la signification, afin de contribuer à la construction d’une civilisation humaniste, progressive et progressiste, ouverte à tous les apports vivifiants, dans un effort pour rassembler et ordonner les efforts de tous les Africains.
Le panafricanisme vise la coopération économique, intellectuelle et politique entre les pays africains. Il exige que les richesses du continent soient utilisées pour le développement de ses peuples. C’est pourquoi il insiste sur l’unification des marchés financiers et économiques du continent par une stratégie nouvelle pour l’accumulation initiale de capital et l’établissement d’une nouvelle carte politique de l’Afrique.
L’esclavage et la colonisation se sont accompagnés de dépouillement, d’asservissement et de persécutions, de discrimination, de subordination, de déshumanisation de la race noire et du sentiment d’infériorité. La résistance va traduire la soif naturelle d’indépendance, de liberté, de dignité, « du désir d’établir une identité commune entre tous ceux qui appartiennent à la race noire, de susciter un sens plus vif de leur solidarité et de leur sécurité ». Il va ainsi se créer une mystique de l’unité, de la parenté politique entre les communautés isolées et déracinées de la diaspora noire d’abord, entre elles et l’Afrique ensuite.
Deux des principaux objectifs du panafricanisme seront alors le réexamen de l’histoire africaine dans une perspective africaine comme par opposition à une perspective pro-européenne, et le retour aux conceptions traditionnelles africaines de la culture, de la société et des valeurs.
Cependant, l’idéologie du panafricanisme est pour le moins assez confuse. Elle le doit en partie à la diversité des convictions idéologiques de ses différents fondateurs. En revanche, il faut dire que certains des premiers leaders du panafricanisme ont été largement influencés par les idées socialistes, voire révolutionnaires qui les engagèrent sur le chemin de la liberté à conquérir.
II – PANAFRICANISME ET MOUVEMENTS DE LIBERATION EN AFRIQUE
Le contexte international de 1917–1945 a été favorable à la fin de la domination coloniale. Il a stimulé la promotion de la liberté de l’homme noir, à travers la philosophie de l’égalité des races et des hommes. Le panafricanisme l’a mis à profit pour rapidement impacter positivement la conscience noire avec la proclamation de la solidarité et l’unité de tous les africains. Il stimula les Noirs dans leur revendication de la dignité humaine. Pour donner force et adhésion à la cause, il fallut visiter l’histoire.
La première guerre mondiale amena les puissances coloniales européennes à faire appel à des soldats originaires de leurs colonies. Les Britanniques lèveront 25 000 hommes en Afrique de l’ouest, dont 12 500 du Nigeria et 10 000 de Gold Coast (actuel Ghana). En Afrique de l’est, outre des combattants, ils recrutèrent 350 000 porteurs non armés. Au moment du bilan, en 1924, on enregistrait 46 618 morts et 40 645 disparus. Les Allemands vont, quant à eux, lever 11 000 soldats africains. La France, elle, non contente de lever 6 000 millions de francs de l’époque en impôts, recruta 211 000 soldats noirs, 270 000 autres en Afrique du Nord et 40 000 autres à Madagascar. On estime à 205 000 morts, ceux des troupes africaines coloniales (honteusement appelées tirailleurs sénégalais) durant cette première guerre mondiale.
Cet enrôlement forcé des soldats africains dans la guerre amènera les Africains à prendre conscience qu’ils avaient, eux aussi, droit à la liberté, une fois la paix revenue. Leur participation à la guerre ainsi que la fréquentation de représentants de mouvements panafricains accéléra l’évolution idéologique du panafricanisme qui va poser la question de l’indépendance des peuples africains. Dès lors dans plusieurs colonies, naissent et s’organisent des mouvements de protestation contre les injustices de l’administration coloniale.
Assez rapidement, les contestataires passeront de la résistance passive aux grèves, notamment là où s’était créé un prolétariat urbain. 1935 dans les mines de cuivre de Rhodésie, 1939 à Mombassa, la révolte des agriculteurs en Côte d’Ivoire, la grève de 72 jours en Guinée…., etc. Ces manifestations conduiront plus tard aux mouvements syndicaux puis à la naissance de partis politiques.
En 1935 survint l’attaque brutale de l’Ethiopie, qu’on appelait alors l’Abyssinie, par les armées de l’Italie fasciste dans l’indifférence complice des grandes puissances. Tous les Africains en Europe se sentirent concernés. La défaite de l’Ethiopie sonna comme un appel à l’unité du continent contre le colonialisme.
Les réalités de la deuxième guerre mondiale, avec ses atrocités et ses misères, avaient affaibli les pays colonisateurs. La Grande Bretagne avait, cette fois, engagé 169 000 « volontaires » d’Afrique occidentale. Ce que ces colonisés vont voir de ces pays, de leurs peuples, de la guerre avilissante, a descendu le colonisateur du piédestal qu’il s’était lui-même construit. Et le mythe du colon s’effondra de lui-même.
A la fin de la guerre, en 1945, les conditions historiques, politiques, économiques et culturelles paraissent réunies pour lancer le mouvement de revendication nationaliste à travers le monde. Le refus des injustices coloniales prendra la forme de révoltes. Ces dernières sont noyées dans le sang comme en 1945 à Sétif en Algérie ou en 1947 contre le MNRM à Madagascar ou encore les grévistes de Lourenço Marques au Mozambique, en 1952 contre les Mau-Mau au Kenya, en 1954-1955 contre l’UPC du Cameroun.
La forme de luttes de libération ou même la forme de mouvements pacifistes était massacrée par les forces d’occupation coloniales. La lutte ne s’arrêta pas pour autant jusqu’à l’indépendance politique des peuples africains. A ce stade, l’on peut dire que le panafricanisme a atteint, mais partiellement son objectif. Seulement, il a été mis en veilleuse même si le temps continuait à véhiculer l’esprit. L’on peut alors se demander qu’en est-il de ce mouvement aujourd’hui?
III – AUJOURD’HUI, LE PANAFRICANISME
Le Panafricanisme a connu ses moments héroïques, ses heures de gloire dans la dernière phase de la période coloniale, et pendant les luttes qui ont été organisées à partir des années 1960 contre la ségrégation raciale, notamment aux Etats-Unis. Durant toutes ces époques, le sentiment de fraternité et de solidarité entre les Noirs de l’Afrique et de la diaspora a été très fort et exaltant.
C’est sous sa bannière que les jeunes africains qui se sont retrouvés en Europe comme étudiants ou comme travailleurs dans les années 1950 et 1960 ont constitué des fédérations d’étudiants (FEANF, WASU, Ligue africaine de la jeunesse…, etc.) ou de travailleurs dans les pays européens où ils se retrouvaient. Ces mouvements se poursuivaient dans les villes africaines où fonctionnaient alors de rares universités (UGEAO ou AED à Dakar.
C’est à son nom que la solidarité de tout le continent s’est manifestée après 1960 à l’endroit des peuples encore sous domination coloniale (britannique, portugaise ou espagnole) et contre la politique de l’apartheid en Afrique du Sud et Namibie.
Une partie des objectifs politiques du panafricanisme a été atteinte : tous les pays africains sont devenus indépendants au moins formellement (exceptés quelques ilôts comme la Guinée Bissau, Sao Tomé et Principé, l’Angola où la lutte de libération s’est poursuivie inlassable). Aux USA, grand pays du racisme, de la ségrégation raciale et des pratiques terroristes du KU KLUX KLAN, les pratiques racistes ont été mises officiellement hors la loi, même si elles n’ont pas totalement disparu dans la réalité.
Cependant, les objectifs d’unité et de solidarité de l’Afrique, de restauration de la personnalité de l’homme noir, et de la construction d’une économie florissante commune à toute l’Afrique sont loin d’être atteints. De même aux Etats-Unis, l’égalité véritable des citoyens, les chances égales pour entrer dans la vie sont toujours à rechercher.
Manifestement, le passé pèse encore d’un certain poids dans ces situations, car elles ont laissé des séquelles durables dans de nombreux esprits et dans toutes les situations sociales.
Certains penseurs africains ont considéré que la vision du panafricanisme et ses objectifs politiques péchaient par le fait qu’ils prônaient l’entente et l’harmonie entre tous les africains ou les descendants africains, où qu’ils soient. Or, les Africains ne sont pas tous égaux devant la richesse, et ils se retrouveront à des positions différentes dans les modes de productions propres à chaque pays ou à chaque région. La vision panafricaniste semblerait donc nier la lutte de classes inévitable et la répartition inégale des richesses et des avantages dans les sociétés africaines.
«L’Afrique aux Africains » était un beau et noble slogan de lutte du panafricanisme. Cinquante à soixante ans après, l’absence persistante de démocratie, la misère généralisée dont sont victimes de nombreux africains sans couverture sociale minimale, la dépendance économique et culturelle de l’Afrique à l’égard de l’Europe et surtout de l’Amérique, la fascination exercée sur de nombreux jeunes Africains par l’Europe et les Etats-Unis, tout cela amène à dire que comprise au premier degré, ce slogan est loin d’être entièrement juste. Il eut fallu approfondir les conditions à remplir par ceux des Africains qui ambitionnaient d’exercer le pouvoir dans leur pays. Et ces conditions auraient dû correspondre aux bonnes réponses à donner aux questions suivantes :
.Quel est le but poursuivi et les objectifs intermédiaires visés par les candidats dans la gestion du pouvoir
.Suivant quels principes sera assurée la gouvernance du pays?
·Le pouvoir respectera-t-il la souveraineté du peuple et son droit à la libre expression?
·Quelles sont les qualités personnelles des hommes qui constitueront les équipes dirigeantes?
·Le principe de l’imputabilité sera-t-il respecté par tous, à commencer par le premier dirigeant?
Ces questions, parmi tant d’autres, n’ayant pas été posées, il ressort aujourd’hui qu’une proportion importante d’Africains s’interroge: qu’avons-nous fait de l’indépendance?
C’est la recherche des réponses qui constitue la tâche du panafricanisme renaissant. Cette réflexion semble avoir donné un coup de fouet à certains leaders. Ceux-ci essaient de le remettre sur scelle, mais les Présidents manquent du patriotisme des pères fondateurs de nos Etats modernes. Ils sont simplement égoïstes et surtout autistes aux cris de misère des populations africaines.
IV – RENAISSANCE PANAFRICAINE
Après les indépendances africaines, le panafricanisme a perdu de sa dynamique. Il a fallu attendre le réveil de la Haute Volta devenue Burkinabé sous le Conseil National de la Révolution (CNR) de Thomas Sankara (1983-1987). Le jeune Président, dans l’esprit du panafricanisme, créa en 1985 un Institut des peuples noirs (IPN). Il devait être un instrument de recherches sur l’histoire et la culture des peuples africains ainsi que de la diaspora noire.
Une grande conférence internationale avait précédée la mise en place. Il s’assignait également comme objectifs de lancer le réveil d’un nouveau panafricanisme militant. Sa vocation était de rassembler des chercheurs noirs de tous les continents pour leur faire bénéficier de soutiens de multiples origines.
Mis en veilleuse après la chute du CNR et l’assassinat de son leader, cet institut existe encore, mais n’a plus qu’une vocation nationale et ne dispose pratiquement pas de ressources pour son fonctionnement. Il faut en outre rappeler que le CNR avait lancé de grandes manifestations de solidarité avec la lutte anti-apartheid de l’ANC en Afrique du Sud, et qu’il n’avait pas hésité à signifier à la France de Mitterrand sa désapprobation, lorsque celle-ci a reçu très officiellement le Président d’Afrique du Sud, Pieter Botha à Paris.
Aussi faut-il le dire, ici, depuis les années 50 les femmes sont aux côtés des hommes dans des luttes pour la libération de l’Afrique. Elles mènent une bataille inlassable pour la survie de la famille : travaux domestiques, champêtres en milieu rural ainsi que du combat politique.
Mais elles demeurent toujours des mémoires absentes. Garantes des traditions et donneuses de vie, elles ne sauraient être occultées à l’aube de la renaissance africaine. Continent meurtri par tous les fléaux et dont les Afro-pessimistes prônent le chaos, il a vivement besoin de l’énergie, des idées-forces, des images édifiantes. En Guinée, nous avons eu M’Ballia Camara, Loffo, Jeanne Martin Cissé et avons maintenant Saran Daraba, Fatou Bangoura, plus d’autres.
Au Mali, il y a eu Awa Keita la vaillante malienne et d’autres. Au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. En Côte d’Ivoire, c’est la marche des femmes du Grand Bassam d’Henriette Diabaté. Car de par leurs luttes historiques, ces femmes à poigne ont une fonction naturelle d’impulsion. Elles dégagent des ondes libératrices que l’homme noir doit reconnaître et intégrer.
Certaines de ces femmes ont créé leur parti politique (RBB, Saran Daraba en Guinée, Awa (USRDA) au mali). En le faisant, elles ont battu campagne contre des hommes hostiles à leur présence en politique. Mal qui, aujourd’hui encore, mine l’Afrique.
Visionnaires, certaines annonçaient déjà les heurts et les malheurs de l’Afrique autant que ses problèmes brûlants en se mobilisant pour la prévention de la paix et de la sécurité sur le continent. Awa du Mali était consciente de l’importance de l’union soudanaise. Elle était à n’en pas douter l’une des pionnières de l’unité africaine. De part une actualité morose, ici et là, comment peut-on oublier ces figures féminines de proue et ces visages glorieux libérateurs ?
C’est pourquoi, il faut restituer l’histoire et apporter à la refondation panafricaine, des jalons novateurs par la quête imminente de l’intégration effective des femmes africaines dans le processus décisionnel en ce vingt et unième siècle et en ce monde globalisant.
«Et si nous célébrions les femmes du passé et du présent ? Ces mères qui ont forgé des destins de héros, guides de leur peuple ou accompli des sacrifices hors du commun ? Nombreuses sont celles qui se sont illustrées, dans l’histoire ou dans la diaspora, mais les écrits ne leur consacrent que peu de place. Si la tradition orale perpétue le souvenir de certains d’entre elles, vous ne trouverez nulle trace de ces figures, même dans les meilleures publications. Malgré son rôle prépondérant dans la société traditionnelle, la femme noire n’accède jamais au statut d’héroïne.»
«La femme est le cœur de la vie de notre société. Il n’en demeure pas moins que quelques malins esprits se plaisent à la ravaler à une espèce de second rang par rapport à l’homme. Nous ne pourrons d’aucune façon nous développer réellement si cette situation n’est pas combattue. »
Mais il ne suffit pas de célébrer la femme africaine seulement. Le retour aux affaires politiques d’Olosegun Obasanjo au Nigeria (1999 à 2007) ainsi que la brillante élection de Thabo MBéki comme deuxième chef d’Etat postapartheid (1999-2008) avaient ravivé au sein de la communauté africaine intérieure et expatriée une originalité amorçant une ère nouvelle qui prédisait de profondes mutations nécessaires pour la rénovation du continent, transformation radicale que Thabo MBéki avait baptisée «la renaissance africaine ». Il en est de même de l’élection d’Obama aujourd’hui expression de la fierté de l’Homme noir, mais surtout une lumière qui doit éclairer l’action africaine et insuffler un nouveau message: «Yes we can».
Oui, si les Africains veulent réaliser l’Unité Africaine pour la refondation du continent noir au profit de la race Noire, ils ne pourront. Pour cela, nous devons avoir en mémoire, les impératifs de l’Afrique pour lesquels l’ensemble de ses structures, généralement héritées du jacobinisme et du centralisme étatique sont en panne d’imagination. N’est-ce pas qui affecte son décollage économique, social, culturel et son marché toujours réduit à ses matières premières ? L’une des causes est cet affichage d’une mosaïque de pays fragmentés qui jouent très souvent le rôle de succursales de quelques empires anciens ou nouveaux sinon champ ouvert au lobbying international au lieu d’être un outil de promotion et de développement de cette Afrique des braves populations ; de cette Afrique aux «braves guerriers des savanes ancestrales» que célébrait le poète B. Diop. Cet état de fait exige de toute conscience noire le nettoyage, en profondeur du paysage politique africain afin de permettre la transformation, en réel, du rêve de l’Unité Africaine.
Alors, disons que dans la vision prospective, les grandes mutations présentes et à venir de l’Afrique ne doivent pas occulter son retard dû, en partie, à son actuelle balkanisation. Or, une société divisée n’est pas viable, ni fiable, car en découlent marginalisation et vassalisation. Il est également et surtout la conséquence de la focalisation du panafricanisme sur l’identité raciale au cours de son combat au détriment de la mise en place d’institutions fortes, motrices et promotrices du vrai développement qui a façonné les grandes nations.
M. Jacques KOUROUMA est l’éditeur de